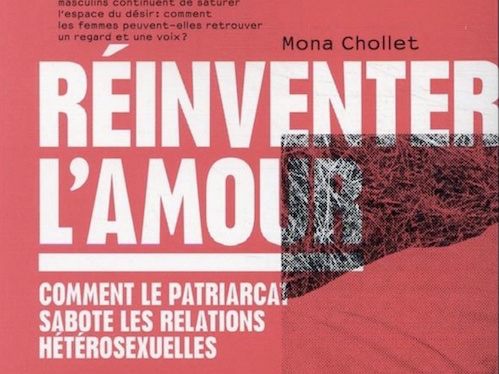Le poids insidieux de la norme patriarcale

Par Léa Malou
Dans mes rêves de petite fille, j’attendais le prince charmant avec la peur de rester célibataire comme ma tante, sans enfants…
J’acceptais comme toutes les filles l’adage « il faut souffrir pour être belle », sans jamais me poser la question : être belle pour qui ? pour quoi ? C’est notre condition, ça ne se discute pas… comme la douleur mensuelle des règles, les cheveux longs à démêler, les jupes qui nous empêchent de grimper partout… autant de douleurs ou d’empêchements qu’on intériorise parce que normales.
Plus tard, étudiante et donc éloignée de ma famille, j’ai rencontré quelques princes charmeurs et, jeune fille, j’ai paniqué à chaque retard de règles qui me terrorisait… Que faire si je me trouvais enceinte ? Péché inavouable aux parents (mariés eux à 19 et 20 ans). Mon père nous laissait entendre « Si une de mes filles déshonore la famille... » et je ne pouvais imaginer la sévérité de la sentence…
Vivre tout en faisant semblant d’être une fille « honorable » pour mes parents… Je me souviens de ce rendez-vous inopiné avec eux dans le bureau du directeur de l’établissement supérieur où j’étais inscrite et de leur débarquement dans mon appartement à Lyon que je partageais avec deux amies. Les murs étaient couverts de photos du magazine « Votre beauté » que ma mère achetait. Images toutes plus dénudées les unes que les autres mais esthétiquement irréprochables !
J’eus droit à quelques remontrances et un rappel à l’ordre, mais pas à un retour forcé dans le giron familial comme ce fut le cas pour ma sœur aînée…

Quand s’est posé le choix d’une profession, il a été guidé par la nécessité de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale : l’enseignement s’est imposé devant l’éducation spécialisée plus chronophage et moins adaptée aux périodes scolaires des futurs enfants que j’aurai. Mais c’était sans la conscience du poids de la norme qui pesait sur moi.
Quand le prince charmant est arrivé, (enfin, le voilà!) j’avais presque 20 ans mais toujours pas la majorité pour se passer de l’autorisation parentale de prendre une certaine pilule. Arrachée de force à la moralité bourgeoise par ces premières féministes à qui nous devons beaucoup, elle nous a donné la liberté de choisir ce que nous voulions vivre… Enfin pouvoir réguler notre fertilité et ne plus angoisser tous les mois, car, à part le préservatif, pas d’alternative.
Mes parents étaient modernes et ont accepté certaines entorses à la bienséance bourgeoise du mariage. Pas de robe de mariée traditionnelle ni de voile, faire part de mariage plutôt original…. J’affirmais ainsi mon refus des normes en douceur… refus qui ne remettait rien en cause.
Je commençais ensuite à faire des remplacements dans les établissements scolaires et dès ma grossesse, décidais de surseoir à mon emploi pour élever mon enfant.
Avec ce premier bébé, je me suis sentie enfin une femme, une vraie ! J’étais passée par les douleurs de l’enfantement, je faisais partie du cercle des initiées. Certes, on m’avait surtout parlé de l’aspect merveilleux de la maternité, on avait minimisé l’horreur de la chose avec cette préparation à l’accouchement « sans douleur »… J’en voulais aux femmes, à toutes les femmes, de m’avoir “menti”, mais c’était le prix pour en faire partie.
Enfin, maintenant, j’avais ma guerre à moi à raconter, tout comme les hommes leur service militaire.
J’ai eu envie de mourir pour ne plus souffrir… Médecin dérangé de nuit, j’ai su après qu’il m’avait fait injecter un produit pour activer les contractions… On appellerait cela aujourd’hui de la maltraitance médicale, mais ça n’existait pas encore… En discutant avec une sage-femme, elle me dit : “La prochaine fois, vous nous ferez confiance”... Mais oui, pourquoi avais-je cru la présence du médecin obstétricien nécessaire ? Pourquoi ?
Ce médecin qui me faisait mettre totalement nue devant lui assis, et m’approchait entre ses jambes pour me parler de la pudeur… Ce vieux médecin qui avait la réputation de bien préparer les femmes à l'attouchement l'accouchement !
Oui, je me le tins pour dit !
Avec un enfant, je découvrais les nuits agitées, les tétées avec les bons et mauvais côtés, le sevrage angoissant, mais aussi beaucoup de bonheur et de l’amour à profusion qui me faisait penser : ça valait la peine de souffrir pour connaître cela…
Après le garçon, il me fallait bien tenter la fille ! Gagné ! une petite « soeurprise » (Notez que nous ne pouvions pas encore connaître le sexe de l’enfant) est arrivée 3 ans après. (Remarquez que la pilule nous a permis d’espacer les naissances à l’inverse de nos parents : nous étions 3 en deux ans et demi).
La norme m’a vraiment sauté aux yeux quand j’ai consulté pour ma troisième grossesse. Le jeune interne me questionne et je lui dis que c’est mon troisième enfant (j’avais 28 ans). Il en faut bien 3 pour faire une vraie famille ! D’autant plus que je suis la troisième de la « sororie » et que je ne pouvais, alors, concevoir ma non-existence par pur égoïsme ! Et le médecin de me répondre :
« S’il faut, il faut ! » Ce fut un coup de massue pour ma soi-disante autodétermination…
Si, dans ce récit au féminin, je ne parle pas du géniteur, mon Prince Charmant, amoureux et confiant, c’est que, les rôles étant tracés dès le départ de notre vie conjugale, il n’y a pas eu matière à discuter. Lui, tout attaché à son métier qui nous nourrissait et au développement de sa carrière que nous suivions de ville en ville, accomplissait son travail de chef de famille : faire au mieux pour nous permettre de nous épanouir ensemble. Tôt levé, rentré tard, il ne pouvait pas beaucoup participer aux travaux ménagers, dormait avec des boules Quiès… Nos fonctions étaient bien délimitées, nous accomplissions tout ce qui nous était imparti. Mère de famille, sans emploi, disait-on alors, je l’ai souvent vécu comme un privilège. J’ai milité dans une association humanitaire, fait de la poterie, du théâtre… tout en suivant la scolarité des enfants comme le font toutes les mamans.
Les enfants grandissant, les rôles parentaux évoluant, le partage des tâches a été redéfini. J'ai repris mon travail après 10 ans d’arrêt. Je me revois à 7 heures du matin, au volant de ma voiture, parmi le flux roulant vers le bureau, l’usine ou l’école… et ma fierté d’en faire partie, avec ce sentiment d’utilité sociale qui me galvanisait. Je retrouvais par ce retour au monde du travail un sentiment de valeur ajoutée, de puissance nouvelle, celle de pouvoir me réaliser autrement.
Aujourd’hui, mes petites-filles auront-elles la chance d’être moins déterminées par ces normes patriarcales ? Pourront-elles faire des choix de vie selon leur désir ? Feront -elles confiance aux femmes ? A celles qu’elles sont et à celles qu’elles rencontreront ?
Si du point de vue du sexisme il semble que ça bouge, que les injonctions de genre sont moins pesantes, il reste encore du chemin à faire pour conscientiser nos déterminismes.
Cet article vous a plu ? Pour encourager la publication
des prochains numéros, inscrivez-vous simplement à notre newsletter !
La pépite vintage #6
Dans les années soixante, on est réticent à sortir les femmes de la case « foyer », pour les faire entrer dans la case « travail ». Il est de bon ton de leur ouvrir les possibilités d’avoir un métier, mais, dans les faits, c’est à la maison que se trouve véritablement leur « place ».
Le nerf de la guerre
En 1965, ma mère commence à travailler, au grand dam de mon père qui craint comme la peste cette ouverture vers l’extérieur : tout cela ne présage rien de bon...